Réinvestir l’imaginaire : reprendre la barre face à l’aliénation capitaliste
- mdv
- 8 août 2025
- 10 min de lecture
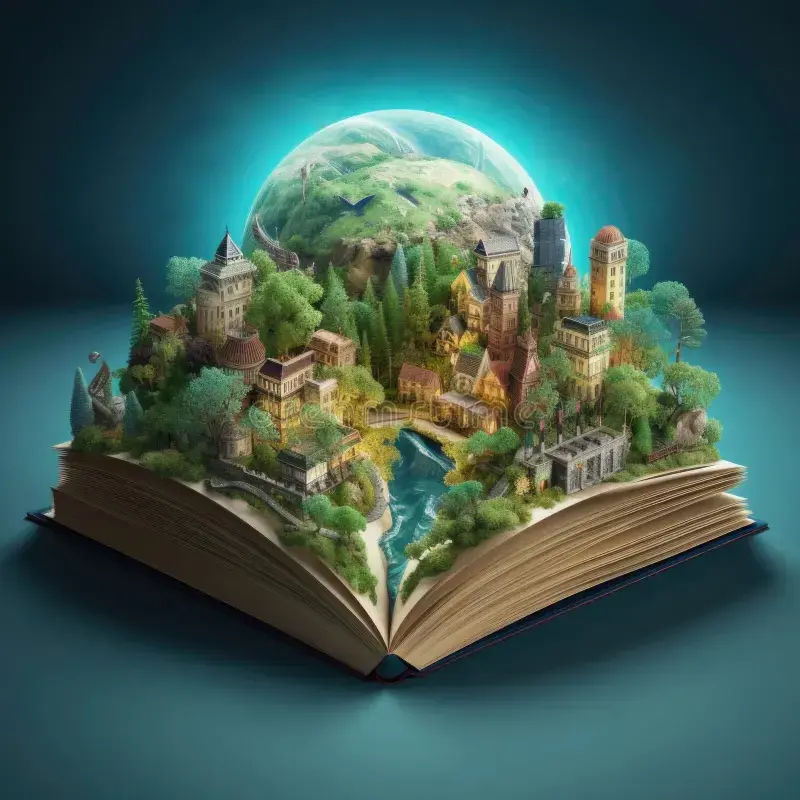
L’imaginaire capitaliste, un pilote automatique aliénant
Le capitalisme ne fonctionne pas seulement avec des usines, des marchés et des lois économiques – il repose avant tout sur un imaginaire social puissant. Cet imaginaire capitaliste impose une vision du monde préformatée, fondée sur la compétition, la prédation et la domination. Il valorise l’accumulation illimitée, la consommation sans fin et la marchandisation de chaque aspect de la vie. Au fil du temps, cet imaginaire s’est autonomisé et fonctionne comme un pilote automatique : nous évoluons à l’intérieur de ses valeurs comme s’il s’agissait de la seule réalité possible.
Selon le philosophe Cornelius Castoriadis, une société est autonome lorsque qu’elle sait qu’elle crée elle-même ses lois et significations, et hétéronome lorsqu’elle subit des règles qu’elle croit imposées de l’extérieur. Sous l’emprise de l’imaginaire capitaliste, nous vivons dans un état d’hétéronomie insidieux : les êtres humains se conforment à des objectifs dictés par le système (croissance, profit, consumérisme) en oubliant qu’ils pourraient les remettre en question. Ce système nous aliène en orientant nos désirs et nos comportements selon ses propres besoins, souvent aux dépens de nos aspirations profondes et du bien commun. Le résultat, c’est une impression diffuse d’être dépossédé du sens de nos actions, d’avoir remis la barre de notre vaisseau à une logique extérieure.
Pour un public déjà sensibilisé à la nécessité d’émancipation, ce constat renforce l’urgence d’une sécession intérieure vis-à-vis de cet imaginaire prédateur. Il ne s’agit pas de nier la réalité matérielle du capitalisme, mais de cesser d’en faire l’horizon indépassable de nos vies. C’est en prenant conscience de l’emprise de cet imaginaire dominant que l’on peut commencer à s’en dégager. Rejeter ce pilote automatique aliénant est la première étape pour reprendre en main notre destinée collective.
Oser imaginer d’autres voies
Se libérer de l’imaginaire capitaliste ouvre une question vertigineuse : que pourrait-on imaginer à la place ? Réinvestir l’imaginaire, c’est redécouvrir notre pouvoir de créer d’autres visions du monde, d’autres valeurs pour guider la société. L’histoire montre que les êtres humains ont continuellement inventé de nouvelles significations collectives – des mythes fondateurs aux idéaux des Lumières. L’imaginaire social est une création permanente. Il est donc crucial de raviver cette faculté d’imagination radicale pour esquisser des alternatives au récit unique du capitalisme.
Un nouvel imaginaire émancipateur pourrait reposer sur des valeurs inverses de celles du système actuel : la coopération au lieu de la compétition, la sobriété et la régénération plutôt que l’exploitation effrénée, la pluralité des valeurs au lieu du seul profit. Il s’agit d’imaginer une société où l’économie serait remise à sa juste place – comme un moyen et non une fin en soi – et où d’autres finalités collectives pourraient s’épanouir (épanouissement personnel, justice sociale, harmonie avec le vivant, etc.).
Concrètement, réinvestir l’imaginaire veut dire raconter d’autres histoires et inventer d’autres pratiques. Cela peut passer par la création artistique, la science-fiction, les utopies concrètes, mais aussi par le fait de donner à voir des initiatives réelles qui incarnent d’autres rapports sociaux. En donnant de la visibilité à des modes de vie alternatifs, en valorisant des héros du commun plutôt que les seuls entrepreneurs milliardaires, on alimente un imaginaire alternatif. Ces nouveaux récits et images offrent aux esprits une palette élargie de ce qui est désirable et possible. Ils rouvrent le champ du possible là où le capitalisme prétendait qu’« il n’y a pas d’alternative ».
S’émanciper de la prédation par la sécession imaginaire
Réinvestir un nouvel imaginaire demande aussi une forme de sécession culturelle vis-à-vis du système dominant. Il s’agit de prendre du recul par rapport aux valeurs capitalistes inculquées dès le plus jeune âge. Cette sécession peut être intérieure (changer sa façon de voir le monde, désapprendre la compétition comme valeur suprême) mais aussi concrète et collective (créer des communautés ou des réseaux en marge du système marchand classique). L’objectif n’est pas de fuir la société, mais d’y insuffler progressivement d’autres façons de vivre et de coopérer.
En nous détachant de l’imaginaire prédateur, nous pouvons expérimenter d’autres rapports sociaux fondés sur l’entraide, la bienveillance, le respect de la nature et des êtres. Cela passe par le local et le concret : relocaliser des activités, partager des savoir-faire, reprendre du pouvoir sur la production de nos moyens de subsistance. Ces démarches s’accompagnent d’un imaginaire de la limite (accepter que la croissance infinie est impossible, imaginer la prospérité dans la frugalité) et de la communauté (se voir comme partie prenante d’un tout, et non comme un individu isolé en compétition).
De nombreuses luttes actuelles – qu’il s’agisse des mouvements écologistes prônant la décroissance, des communautés en transition, des défenseurs des communs – participent à cette élaboration d’un autre imaginaire. Elles proposent de nouvelles significations collectives : par exemple, considérer la Terre non plus comme un stock de ressources à exploiter, mais comme un patrimoine vivant dont nous sommes les gardiens, ou voir la réussite non pas comme l’accumulation de richesse matérielle, mais comme la qualité des liens humains et le bien-être global. Pour que ces idées percent, il faut leur donner une force imaginale au moins aussi puissante que celle de la consommation et du profit. Autrement dit, faire en sorte qu’elles habitent les esprits, nourrissent les rêves et orientent les actions.
Cette démarche est intrinsèquement engagée : s’émanciper de l’imaginaire dominant revient à s’opposer aux structures établies qui en profitent. C’est un acte politique et culturel fort, qui vise à reprendre le pouvoir de définir nos finalités. En réinvestissant l’imaginaire, on redonne sens au mot émancipation : il ne s’agit plus seulement de desserrer une contrainte, mais de s’autoriser à inventer notre monde commun.
Intégrer tradition et modernité pour dépasser l’existant
Un point essentiel dans la construction d’un imaginaire alternatif est d’éviter de simplement opposer « ancien » et « nouveau », « traditionnel » et « moderne ». Au contraire, de nombreuses solutions se trouvent dans un dialogue fertile entre des savoirs ancestraux et des innovations contemporaines. Par exemple, on peut marier les sagesses autochtones sur la gestion de la terre avec les avancées technologiques au service du bien commun.
Réinvestir l’imaginaire demande de sortir des oppositions simplistes léguées par la pensée linéaire du vieux monde. Comme le dit un porteur de projet alternatif : réunir « la modernité et la tradition, le marchand et le non-marchand, la nature et la culture » – tous ces couples antagonistes – dans des pratiques qui intègrent le meilleur de chaque . En effet, l’imaginaire capitaliste a souvent érigé des barrières artificielles entre ces domaines (par exemple opposer l’économie et l’écologie, ou le sacré et le profane), alors qu’une vision holistique permet de les concilier au service d’une vie plus riche de sens.
Cette approche intégrative enrichit l’imaginaire de possibilités inédites. On peut envisager des modes d’organisation où le marchand et le non-marchand cohabitent, où la tradition inspire la transition, où la technologie est mise au service du vivant plutôt qu’à son détriment. C’est en piochant dans la diversité des cultures et des idées – passées comme présentes – que l’on peut tisser un nouveau récit commun, solide et crédible. D’ailleurs, redécouvrir des pratiques anciennes peut légitimer et ancrer l’innovation actuelle dans quelque chose de familier et de respecté. Loin d’un saut dans l’inconnu total, l’alternative s’inscrit ainsi dans la continuité de l’expérience humaine, tout en dépassant les limites de l’imaginaire capitaliste.
Agdal Hayy : un laboratoire d’un imaginaire libérateur
Un exemple concret d’expérience imaginale émergente est le projet Agdal Hayy au Maroc. Pensé comme un « attracteur étrange » sociétal, Agdal Hayy cherche à catalyser une nouvelle dynamique collective qui échappe aux logiques prédatrices. Il s’agit d’un véritable laboratoire d’autonomisation individuelle et collective : à la fois lieu physique, espace communautaire et projet économique, articulé autour de principes radicalement différents de ceux du capitalisme traditionnel.
Agdal Hayy s’inspire de pratiques traditionnelles locales comme l’Agdal (une forme de gestion collective et saisonnière des ressources chez les Amazighs) et le Waqf (le don perpétuel d’un bien au service du bien commun dans la tradition islamique), qu’il marie avec des concepts de communs modernes théorisés par Elinor Ostrom. Concrètement, cela se traduit par une sanctuarisation des terres et leur gestion par une entité collective, plutôt que par la propriété privée classique . Les terrains confiés au projet sont sortis du marché spéculatif et administrés dans l’intérêt des générations futures, un peu à la manière dont un waqf sacralise un bien en le dédiant à Dieu et à la communauté . Ce choix incarne une démarchandisation du foncier : la terre n’est plus vue comme une simple marchandise, mais comme un patrimoine commun à préserver.
Sur le plan économique et écologique, Agdal Hayy promeut l’agroécologie régénérative, la permaculture et l’agro-sylvo-pastoralisme pour restaurer les écosystèmes tout en assurant la subsistance locale. Une micro-ferme pédagogique sert à la fois de centre de formation et de lieu de production à échelle humaine. Les produits agricoles sont transformés localement (moulin traditionnel, fabrication de biscuits hautement nutritifs, etc.) et écoulés via des circuits courts, avec des incitations pour les paysans qui adoptent de bonnes pratiques. On retrouve ici l’idée de reboucler localement les cycles production-distribution-consommation de manière vertueuse, afin de prendre soin à la fois de la planète et des communautés humaines – en recréant des liens forts garants de cohésion .
Au-delà de l’aspect agricole, Agdal Hayy accorde aussi une place à la dimension spirituelle et culturelle. Un espace est consacré comme sanctuaire, un lieu de retraite et d’apprentissage où l’on peut se reconnecter à soi-même et aux savoirs ancestraux, tout en expérimentant de nouvelles façons de vivre ensemble . C’est un espace frontière symbolique entre logique marchande et non-marchande, entre compétition et solidarité, entre le profane et le sacré . En d’autres termes, le projet crée les conditions d’un imaginaire où ces dualités sont transcendées, laissant entrevoir un mode de vie plus équilibré.
Agdal Hayy ne se contente pas d’être utopique sur le papier – il cherche à démontrer la viabilité de son modèle. Localement, il offre aux habitants de la région de Zaouiat Ifrane un modèle de développement qui valorise leur patrimoine et savoir-faire. Globalement, il veut « proposer une alternative concrète à l’exploitation destructrice des ressources » en prouvant que des modèles économiques fondés sur la coopération, la résilience et la régénération peuvent réussir . En faisant coexister tradition et innovation (par exemple, en incorporant même une dimension Web3 avec une cryptomonnaie communautaire pour soutenir le projet), Agdal Hayy élargit l’horizon du possible. Il donne une crédibilité à l’alternative en s’appuyant sur une légitimité culturelle forte et une profondeur historique – intégrant à la fois l’Agdal, le Waqf et les communs – qui dépasse les discours habituels du développement durable .
Garder le cap de l’autonomie pour ne pas recréer de chaînes
Un défi crucial pour tout nouvel imaginaire est d’éviter de reproduire les travers de l’ancien. L’histoire nous enseigne que les révolutions et projets émancipateurs peuvent, en se solidifiant, engendrer à leur tour de nouvelles aliénations. Une idée libératrice peut devenir dogmatique si on cesse de l’interroger. Conscients de ce risque, les artisans d’Agdal Hayy cherchent à anticiper la phase où même un imaginaire alternatif pourrait s’autonomiser et échapper à ceux qu’il est censé servir. Autrement dit, comment éviter que la belle aventure retombe dans l’hétéronomie, avec de nouvelles règles figées et une nouvelle élite dominante ?
La réponse réside dans un attachement indéfectible au principe d’autonomie. Cela signifie instaurer des processus participatifs et évolutifs, pour que la gouvernance reste entre les mains de la communauté elle-même. Dans l’exemple d’Agdal Hayy, l’introduction d’une organisation DAO (organisation autonome décentralisée) appuyée sur la blockchain vise précisément à assurer une gouvernance transparente et partagée par les participants du projet . En ouvrant dès le départ la gestion à l’ensemble de la communauté (locale et élargie), on évite la confiscation du pouvoir par quelques-uns. De même, l’éducation permanente des membres, le dialogue entre savoirs et la diversité des parties prenantes créent une culture du questionnement et de l’ajustement continu.
Plus largement, garder le cap de l’autonomie implique de cultiver l’esprit critique et la réflexivité au sein du nouveau paradigme. Chaque individu doit être encouragé à rester acteur et auteur du système, et non simple exécutant de nouvelles règles. L’imaginaire alternatif ne doit pas devenir un nouveau récit figé devant lequel on s’incline aveuglément. Il doit demeurer un espace ouvert, en perpétuelle co-création, où chacun peut apporter sa boussole intérieure. C’est ainsi qu’on évitera de retomber dans l’aliénation, fût-elle au nom d’une noble cause.
Redevenir maîtres à bord
En fin de compte, réinvestir un imaginaire alternatif vise à redonner à chacun le gouvernail de sa propre vie. Il s’agit de sortir du statut de passager d’un navire lancé à pleine vitesse vers on ne sait quel destin, pour redevenir capitaine capable de changer de cap. Cette métaphore nautique illustre bien l’enjeu : l’imaginaire capitaliste autonome nous avait fait perdre la main sur la trajectoire, mais en reprenant conscience de notre pouvoir d’imaginer et de créer, nous pouvons corriger le cours.
Ce travail de réappropriation est exigeant. Il demande du courage pour remettre en question l’ordre établi, de la créativité pour inventer autre chose, et de la persévérance pour faire vivre concrètement les alternatives au quotidien. Mais le jeu en vaut la chandelle : c’est notre humanité même qui est en cause, notre capacité à n’être pas que des rouages fonctionnels mais des êtres libres et responsables les uns envers les autres.
Face à un système qui réduit tout à des indicateurs quantifiables et des rapports de force, l’acte de rêver à voix haute d’une autre société est profondément subversif. En proposant des voies alternatives, en alimentant un imaginaire nouveau et en le mettant en pratique, nous ouvrons des brèches dans le mur du fatalisme. Peu à peu, ces fissures peuvent laisser passer la lumière d’un monde à venir plus juste, plus autonome, plus vivant.
L’importance cruciale de cette démarche, c’est qu’elle permet de débloquer l’horizon : là où l’imaginaire dominant nous disait « il n’y a pas d’alternative », nous répondons par une pluralité d’alternatives concrètes et tangibles. En réinvestissant l’imaginaire, nous redonnons à la société la capacité de se réinventer elle-même. C’est là le cœur de l’autonomie selon Castoriadis – et la condition pour que nos émancipations ne soient pas de simples échappatoires, mais les premiers pas vers un nouvel art de vivre ensemble, libérés des chaînes invisibles d’un imaginaire aliénant.
En somme, reprendre le pilotage de notre vaisseau collectif nécessitera encore bien des efforts, des expérimentations et des ajustements. Mais chaque initiative comme Agdal Hayy, chaque récit alternatif, chaque utopie concrète nourrit la force imaginale dont nous avons besoin pour naviguer vers d’autres horizons. À nous tous, dès maintenant, de tenir fermement la barre et de tracer la route vers une autonomie réelle, où l’imaginaire ne sera plus une prison, mais un espace infiniment ouvert, à la mesure de notre liberté.



Commentaires