De la Domestication à l’Émancipation : la double leçon de l’agriculture
- mdv
- 25 sept. 2025
- 25 min de lecture
La culture des céréales est souvent associée à un passé peu avenant : instrument de domination des campagnes par les villes, matrice de l’impôt et du contrôle, dévastation environnementale... Ce sombre héritage peut pousser à rejeter ces cultures pour ce qu’elles symbolisent. Mais qu’en est-il réellement ? Cet article propose de séparer le bon grain de l’ivraie : comprendre comment la céréaliculture a pu servir l’asservissement… tout en portant les germes d’une véritable émancipation.
Introduction
“On a l’habitude de dire que la découverte de l’agriculture a radicalement changé le destin de l’humanité en lui assurant une nourriture abondante et en permettant ainsi une croissance prodigieuse de la population. Mais la découverte de l’agriculture a eu des conséquences décisives pour une tout autre raison. […] L’agriculture a révélé à l’homme l’unité fondamentale de la vie organique ; l’analogie femme-champ, acte générateur-ensemencement, etc., ainsi que les plus importantes synthèses mentales, sont issues de cette révélation : la vie rythmique, la mort comprise comme régression, etc. Ces synthèses mentales ont été essentielles pour l’évolution de l’humanité et elles n’ont été possibles qu’après la découverte de l’agriculture.” – Mircea Eliade
Eliade soulignait que l’observation du grain semé a offert à l’homme primitif une vision cyclique et sacrée de la vie. On y voit déjà la leçon paradoxale de l’agriculture : elle a permis l’émergence de la culture— dégradée ensuite en civilisation étatique — et en même temps suscité des intuitions de renouveau et de solidarité avec la nature. Ces analogies organiques se retrouvent dans l’œuvre majeure d’Oswald Spengler, Le Déclin de l'Occident, où il compare les cultures à des êtres vivants qui suivent un cycle naturel de naissance, croissance, vieillissement et mort. Il y distingue clairement la culture de la civilisation. Selon lui, la culture est une période de vitalité créative et d'épanouissement spirituel, tandis que la civilisation est son stade terminal, marqué par le déclin des arts, de la religion, et le triomphe de la rationalité et de la technologie, ce qui marqua le destin des premières cités-états sumérienne où les élites lettrées initièrent le premier processus de civilisation de l’Histoire dont le commencement coïncide avec l’apparition de l’écriture à Sumer.
Dans cet article, nous verrons comment James C. Scott, dans Homo Domesticus (« Against the Grain »), et Fabian Scheidler, dans La Fin de la Mégamachine, éclairent la première face de ce paradoxe, l’agriculture comme machine d’asservissement. Eliade, suivi par Nissim Amzallag et son ouvrage Les graines de l’au-délà, quant à eux, mettent en lumière la seconde (l’agriculture comme inspiration d’une spiritualité immanente et régénératrice). Ensemble, ces perspectives dessinent l’idée que la révolution néolithique contient en germe à la fois la servitude et la libération de l’humanité.
"L'agriculture est certainement la connaissance la plus utile à l'humanité, cependant beaucoup l'ignorent, et presque tous la méprise. Étrange aveuglement !" – Louis Cattiaux
L’agriculture comme fondement de l’asservissement

Champs de blé dorés : l’étendue concentrée des céréales en un même lieu, aux moissons prévisibles, a facilité leur taxation par l’État.
Le cœur de la thèse de James C. Scott est que la culture des céréales a créé un « module » techno-politique clef de l’État naissant. Les grains ont rendu les sociétés lisibles par l’État : concentrables, mesurables, stockables et taxables. Comme l’explique Scott, « seules les céréales à grains […] sont propices à la mise sur pied d’un système de captation et de centralisation fiscales » car elles sont « divisibles, stockables, transportables et surtout moins périssables » que les cultures plus dispersées (fruits, tubercules, etc.). Cette lisibilité a permis l’invention de la comptabilité, de l’impôt et du rationnement.
La sédentarisation liée à ces cultures a fixé les populations à la terre de manière permanente. Un village d’agriculteurs sédentaires se laisse dompter et surveiller : on peut recenser les âmes, prélever les corvées (pour les guerres ou les travaux publics), et mobiliser les paysans comme main-d’œuvre docile. Scott note que cet accroissement de la population sédentarisée s’est accompagné d’une domestication humaine : « les premiers États étaient construits sur la force de travail des paysans ». L’agriculteur est poussé à abdiquer sa liberté en échange de la protection du seigneur local devenant ainsi son “serviteur” (à l’image du « serf », paysan du Moyen Âge lié à une terre et à son seigneur, ne pouvant quitter ce domaine sans sa permission et devant de nombreux devoirs à son maître). Peu à peu se met en place ce que Scott nomme le « module céréalier » : champs, greniers, scribes, soldats et souverain, une machine politique à produire de la hiérarchie, des inégalités et du contrôle.
Pour Scott, le monstre étatique est ainsi un produit technique de la céréaliculture. Les civilisations mésopotamiennes l’ont démontré : là où l’irrigation et le blé dominaient (Mésopotamie, vallée de l’Indus, vallées du Nil ou du Fleuve Jaune), l’État a surgi. À l’inverse, dans les sociétés des terres humides ou à base de tubercules, difficiles à concentrer, les grands États n’ont pas survécu. Les peuples cultivateurs de manioc, patate douce, etc. ont souvent échappé aux premiers grands États en restant hors de leur contrôle fiscal. Enfin, Scott rappelle que les premiers États archaïques étaient instables : leur existence tenait au maintien d’un certain équilibre (l’accumulation forcée de surplus), et dès qu’un désordre survint (crise agricole, guerre, maladie, révolte), les populations en masse préféraient fuir – « voter avec leurs pieds », pour Scott – vers des contrées périphériques comme la zone non étatique de la Zomia (Asie du Sud-Est), où la culture vivrière était plus diversifiée et l’État moins pernicieux.
En résumé, chez Scott l’agriculture céréalière est la matrice de l’État : elle fournit l’excuse et le moyen d’une domination intensive. L’homme céréaliculteur devient par là Homo Domesticus, soumis par principe à la machine hiérarchique. Cette lecture matérialiste nous fait comprendre l’État « ni éternel ni naturel », mais fragile et contingent.
L’asservissement lié à la culture des céréales ne se limite pas au contrôle fiscal et politique décrit par Scott ; il s’exprime aussi par une emprise environnementale dévastatrice. Dès l’Antiquité, la mise en place de grands champs céréaliers a entraîné un déboisement massif pour ouvrir des surfaces cultivables, alimentant ensuite l’érosion des sols et la modification du régime des pluies. La Mésopotamie, berceau des blés, en offre l’exemple dramatique : l’ouverture de champs céréaliers a nécessité des déboisements massifs, l’irrigation intensive a provoqué la salinisation des terres, réduisant leur fertilité et contribuant à l’effondrement de cités entières. Dans le bassin méditerranéen, les pentes couvertes d’oliviers ou de céréales ont accéléré les ruissellements et l’érosion, laissant derrière elles des paysages appauvris. Partout où le module céréalier s’est imposé, il a impliqué un travail titanesque déforestation, de transformation des écosystèmes complexes en surfaces uniformes et fragiles. Cette logique d’arraisonnement écologique, indissociable de la quête d’accumulation et de contrôle, marque l’autre face sombre du grain : en domestiquant la céréale, l’homme a aussi commencé à dégrader la terre elle-même, en la contraignant dans des cycles de production qui l’épuisent au lieu de la régénérer.
L’agriculture comme source de révélation émancipatrice
« Le but ultime de l'agriculture n'est pas la culture des récoltes, mais la culture de la perfection des êtres humains. » – Masanobu Fukuoka
Mais avant même l’État, l’observation des semences a donné aux anciens un tout autre enseignement. Eliade insiste sur la dimension sacrée et cyclique de l’agriculture. Pour les peuples traditionnels, le dépôt de la graine en terre signifie que la mort n’est pas une fin ultime, mais un passage transformateur. Le mythe du Premier Mort (un être primordial tué) montre que, simultanément à la mort apparente, l’humanité découvrait la sexualité et le renouveau des plantes. Autrement dit, « le mort lui-même est assimilé à la semence » : enterré, il connaît une « mort végétale » et attend de renaître comme la plante issue de la graine. Cette image fonde l’idée optimiste que la mort est régénération. Les rituels agricoles (semis, moisson, fêtes de la fertilité) sont alors remplis de cette symbolique : la terre engloutit la graine comme elle enterre les morts, mais promet la renaissance de la vie.
L’analogie entre femme et terre féconde découle naturellement de l’agriculture : les anciens ont vu la terre comme une matrice vivante, et la reproduction humaine comme comparable à l’ensemencement du champ. De là naît chez Eliade la fusion des symboles du champ et de la femme, du sexe et du sol. Dans cette vision holistique, tous les vivants participent à un même cycle cosmique. On sacralise la fertilité non pas en haut d’un ciel lointain, mais au cœur du monde naturel et ses énergies chtoniennes ambivalentes qui seront bientôt personnifié plus tard sous les traits de Dionysos. Comme le note Eliade, cette religion cosmique prend son centre autour du grand mystère de la vie et de la mort, riche en symboles de regénération. Ce refus du séparatisme entre le profane et le sacré inscrit le divin dans le grain germé même, et invite l’homme à percevoir l’unité fondamentale de la vie organique.
Cette perspective s’exprime également dans le christianisme primitif. Jésus lui-même utilisera la métaphore du grain de blé pour signifier le lien mort-vie :
« Amen, amen, je vous le dis : si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul ; mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruit. » (Jean 12,24) .
Par cette parabole, le Christ reprend littéralement l’observation agricole : la graine « meurt » dans le sol pour donner une moisson multipliée. Autrement dit, seul le sacrifice (mort symbolique) engendre l’abondance. Ce message populaire atteste que, depuis les origines agricoles, l’acte de semer est lié au principe spirituel de renaissance et d’espérance.
Dans son ouvrage Les graines de l’au-delà, Amzallag prolonge la perspective ouverte par Eliade en soulignant combien la graine, au-delà de sa fonction nourricière, porte une dimension métaphysique et initiatique. Selon lui, la graine incarne une « porte vers l’au-delà » parce qu’elle concentre dans son enveloppe la promesse d’une vie nouvelle qui ne peut éclore qu’à travers un passage par la mort apparente. Ce « dépérissement germinatif » devient alors une parabole existentielle : la graine nous enseigne que toute véritable fécondité passe par le sacrifice, l’abandon de la forme présente en vue d’une transfiguration. Cette intuition rejoint directement la parabole christique du grain de blé, où le geste agricole devient symbole du don de soi et de la résurrection. En plaçant ainsi la semence au cœur d’une dialectique vie/mort/renaissance, Amzallag montre que l’agriculture ne se limite pas à un fait technique ou économique, mais qu’elle constitue une pédagogie spirituelle universelle, capable de relier l’homme au mystère du vivant et de l’au-delà.
Ainsi, en rapprochant Eliade, Amzallag et les Évangiles, on voit émerger une pédagogie spirituelle du grain, apprendre à consentir à la perte, à l’obscurité et à l’enfouissement pour découvrir la puissance régénératrice de la vie. La tradition alchimique parle de l’agriculture céleste qui cherche à révéler les forces créatrices et à transmuter la matière, symbolisée par le jardinage terrestre, mais à un niveau plus élevé et spirituel. Dans ce cadre, l’agriculture n’est pas seulement un système économique ou politique, mais un laboratoire initiatique qui relie l’homme au mystère du vivant et lui révèle une sagesse pour traverser sa propre existence.
La genèse de l’agriculture : de la « technopoïèse » aux premiers blés ancestraux
L’idée centrale pour Nissim Amzallag est qu’avant la technologie à proprement parler (comme usage utilitaire d’une technique), il existe une phase plus ancienne qu’il appelle technopoïèse : un moment d’exploration fascinée où l’on voit naître une technique pour ce qu’elle révèle du monde (sens, cosmologie), bien avant qu’elle ne soit mise au service de l’efficacité et de l’utilitarisme. Au fil du temps, cette phase juvénile est captée par l’appareil étatique, se « sécularise », et bascule vers la technologie au sens moderne, centrée sur la production, l’utilité et la logique d’asservissement qui caractérise l’appareil étatique voyant d’un très mauvais œil la souveraineté alimentaire et l’autonomie spirituelle des campagnes. Amzallag illustre cette bascule avec la poudre à canon (née de quêtes alchimiques autour du Chi) et l’électricité (d’abord vécue comme fluide cosmique), avant leurs usages pratiques. Il formalise ainsi deux régimes successifs : à la technopoïèse (primat du sens et de l’émerveillement) succède la technologie (primat de l’utilité), la transition allant généralement dans ce sens unique.
Comment arrive-t-il à cette conclusion mobilisant l’archéologie et la symbolique ? En remontant au Natoufien (Proche-Orient, avant le Néolithique), Amzallag observe une imbrication étroite entre semences, habitat et sépultures : crânes prélevés et exposés aux seuils des maisons, outils à grains déposés dans les tombes, accumulation de graines en contextes rituels, reconstructions d’habitations sur d’anciens sites d’inhumation. Ces constantes, visibles bien avant une agriculture « productive », suggèrent que la mise en culture a d’abord porté une visée symbolique. D’où son hypothèse : on a commencé à cultiver non pour manger plus, mais pour orchestrer un transfert de vitalité entre morts et vivants, les plantes germant sur ou près des tombes des ancêtres devenant les médiatrices privilégiées de ce passage. Il parle alors de « graines-ancêtres » : des lignées perçues comme chargées d’une force ancestrale.
Le cœur de la thèse : cultiver le blé pour des raisons subtiles. Dans ce cadre, le blé ainsi que d’autres annuelles auraient été mis en culture parce qu’on y voyait des signes tangibles de survitalité autour des sépultures : des îlots d’épis restant verts plus longtemps au milieu des champs jaunis. Ces phénomènes auraient été interprétés comme la preuve sensible d’un passage d’énergie vitale des défunts vers les plantes, justifiant des coupes rituelles d’épis encore verts (les premières faucilles s’expliquant mieux ainsi que par la « récolte alimentaire »). Ce rituel aurait initié la constitution patiente de lignées de graines privilégiées (les « graines-ancêtres »). Celle-ci trouve un écho actuel dans l’appellation de « blés anciens » largement documentés par la recherche scientifiques du monde occidental, mais qu’il serait peut-être plus approprié d’appeler « blés ancestraux » sous d’autres cultures moins portées sur la classification et la catégorisation systématique du vivant.
Pour rendre ce scénario matériellement crédible, Amzallag mobilise des avancées récentes en biologie et propose un argument « bio-génétique »:
Premièrement, au niveau de la physiologie végétale : la décomposition organique enrichit localement le sol en polyamines, molécules connues pour retarder la sénescence et moduler croissance et fructification. Sur un plan visible, cela peut créer ces « taches vertes » tardives autour des tombes, donnant un appui empirique au ressenti rituel des « plantes survitales ».
Deuxièmement, Amzallag avance que la présence accrue de polyamines (putrescine, spermidine, spermine) autour des sépultures — issues de la décomposition organique et des dynamiques microbiennes — a pu créer, dès les débuts, des micro-niches de « survitalité » pour certaines plantes annuelles, en particulier les blés. Ces petites molécules, connues pour stabiliser les acides nucléiques, retarder la sénescence, moduler la division cellulaire et améliorer la tolérance au stress (hydrique, salin, oxydatif), auraient favorisé des levées plus rapides, des tiges plus vigoureuses et un verdissement prolongé au voisinage des tombes. Vu depuis l’expérience sensible des anciens, ces « taches vertes » tardives étaient le signe tangible d’un transfert d’énergie vitale des morts vers les vivants à travers la plante. D’où des coupes rituelles d’épis vigoureux et la mise à part de ces graines perçues comme plus « chargées », qui deviennent des graines-ancêtres. Répété sur des générations, ce biais de collecte — renforcé par des effets épigénétiques (mémoire de stress transmise aux descendants) susceptibles, avec le temps, de se fixer génétiquement — aurait orienté une autodomestication : sélection spontanée de lignées plus dociles, synchrones et productives sans qu’un projet agronomique conscient ne soit d’abord nécessaire. Autrement dit, les polyamines auraient servi de pont bio-symbolique entre culte des morts, perception d’une vitalité accrue et évolution directionnelle des premières lignées céréalières.
En résumé, chez Amzallag, la technopoïèse précède la technologie : les premiers semis de blé relèvent d’une cosmologie pratique — transmettre la vie des morts aux vivants par la graine consommée rituellement —et ce geste, soutenu par des effets biologiques plausibles (polyamines, héritages épigénétiques), aurait enclenché, génération après génération, la domestication par sélection de grains de plus en plus intéressant sur la plan nutritionnel, avant que l’utilité productive ne prenne le relais pour finalement en arriver au désastre actuel consécutif à la « révolution verte » sur laquelle nous reviendrons plus loin, non sans avoir établi au préalable une analogie triplement éclairante.
De la technopoïèse à la civilisation : un parallèle avec Spengler et Tönnies
La distinction proposée par Amzallag entre technopoïèse (phase créative, émerveillement, symbolique) et technologie (phase utilitaire, orientée vers la production et l’efficacité) trouve un écho frappant dans la dialectique de Spengler évoquée en introduction entre Kultur et Zivilisation. Chez Spengler, la culture est ce moment incandescent où une civilisation naît d’un imaginaire organique, religieux, artistique — un élan vital qui s’exprime dans les formes symboliques. La civilisation, elle, survient lorsque cet élan s’épuise, se fige en techniques, en administration et en rationalisation utilitaire : c’est le règne de la forme vidée de son âme. Ce que Spengler décrit à l’échelle des grandes cultures historiques, Amzallag l’observe dans la genèse des techniques : la technopoïèse comme jaillissement symbolique initial, la technologie comme mécanisation secondaire.
Ce parallèle peut encore être éclairé par la distinction d’un des pères de la sociologie moderne, Ferdinand Tönnies, entre Gemeinschaft (la communauté) et Gesellschaft (la société). La communauté correspond au tissu organique, affectif, enraciné dans la vie partagée et les cycles naturels — elle résonne avec la technopoïèse et la Kultur. La société, en revanche, se définit par des rapports instrumentaux, contractuels et abstraits : elle s’aligne sur l’ère de la technologie et de la Zivilisation. Dans ces deux schèmes, on retrouve la même dialectique : un premier moment d’enracinement vital et symbolique, suivi d’un second moment d’abstraction, de rationalisation et d’instrumentalisation.
Ainsi se dessine une grande analogie : technopoïèse = Kultur = Gemeinschaft, d’un côté ; technologie = Zivilisation = Gesellschaft, de l’autre. Ce qui permet d’élargir la thèse d’Amzallag : la perte de vitalité n’est pas propre aux techniques, elle affecte aussi les sociétés et les cultures dans leur totalité — un passage de l’organique à l’artificiel, de l’imaginaire fécond à l’insatiable machine d’extraction de forces vitales que constitue l’appareil étatique dont la genèse actuellement connue remonte à l’aube de l’Histoire et aux premières cités-états sumérienne dont l’une d’elle, Ur, fut la cité-état d’origine d'Abraham.
Le désastre de la « révolution verte »
Bien avant les engrais de synthèse et les semences hybrides, l’humanité a puissamment remodelé — et souvent dégradé — les milieux. Les plaines de Sumer en offrent un exemple classique : l’irrigation intensive y a provoqué, sur des siècles, une salinisation des sols qui a contribué à l’affaiblissement des cités. Dans l’Antiquité grecque, Platon décrit déjà une Attique déboisée et ravinée, mémoire d’une couverture forestière disparue et de sols emportés par l’érosion. Autour du Levant, l’extraction massive de cèdres du Liban par les Phéniciens et leurs successeurs a laissé une empreinte profonde sur les forêts méditerranéennes. En Chine, le plateau de Loess — surexploité, défriché et surpâturé — est devenu au XXᵉ siècle l’une des régions les plus érodées au monde, avant d’engager, tardivement, de vastes programmes de restauration. Plus près de nous, le Dust Bowl des années 1930 aux Grandes Plaines américaines a montré comment l’articulation maladroite entre mécanisation agricole et sécheresse peut déclencher des tempêtes de poussière, des pertes de sols et un exode massif. Et en Mésoamérique, des travaux récents relient déboisement maya et sécheresses sévères au stress agro-écologique puis au déclin de certaines cités.
Ce constat, Élisée Reclus l’avait déjà formulé à sa manière : « l’homme est la nature prenant conscience d’elle-même », écrivait-il en tête de L’Homme et la Terre, pour rappeler à la fois notre pouvoir de transformation et notre responsabilité dans les équilibres du vivant. Autrement dit : l’homme peut faire œuvre de soin comme de saccage — la « révolution verte » n’a fait qu’industrialiser des tendances anciennes, en en démultipliant l’échelle et la vitesse.
A ce stade, il convient de remettre en cause de façon radicale les pratiques agro-industrielles héritées de la « révolution verte » et de ses désastreuses conséquences ainsi que d’exposer le bluff sur lequel elle repose. Il faut bien le dire et le rappeler, cette « révolution » découla directement de la reconversion d’une partie de l’apparail militaire. Les usines qui produisaient des bombes utilisaient de grandes quantités de nitrates et de composés azotés - notamment le TNT et autres explosifs à base d’azote, après 1945, ces filières ont été reconverties vers la fabrication d’engrais azotés chimiques - ammonitrate, urée, etc., en s’appuyant sur la même chimie de fixation de l’azote développée au début du XXᵉ siècle (procédé Haber-Bosch). Les tanks et jeeps : les chaînes de production de chars, camions et blindés ont rapidement été adaptées pour fabriquer des tracteurs et de la machinerie agricole. Cela correspondait à la fois à une stratégie économique (reconversion industrielle d’après-guerre) et à une volonté politique d’augmenter la productivité agricole. Cette reconversion a été un moteur majeur de l’industrialisation agricole d’après-guerre, qui a ouvert la voie à la « révolution verte » des années 1950-1960. En pratique, une partie de l’appareil militaire s’est donc transformé en appareil agro-industriel, exporté ensuite massivement vers le reste du monde.
Autrement dit, l’homme n’a rien trouvé de mieux à faire que déclencher une nouvelle guerre mondiale, cette fois-ci contre la nature, sous couvert de soucis de rendement et de productivité dans le cadre de l’émergence de la société de consommation et d’abondance. Une regrettable évolution régressive largement alimentée par les traumatismes collectifs de deux grandes guerres au court desquels le peuple aura souffert plusieurs épisodes de famine. Des pratiques malgré tout aussi stupides qu'irresponsables qui œuvrent depuis lors à la destruction systématique à échelle industrielle de la biodiversité du vivant, incluant sa dimension « invisible » : la vie microbienne des sols. De ce point de vue, la solution finale des nazis apparait comme une répétition... Par extension, comme assez clairement mis en évidence par l'ancien chercheur l'INRA Christian Rémésy et son concept de "nutri-écologie", cette dégradation du milieu environnemental conduit également et pour ainsi dire mécaniquement à la destruction de la santé humaine si intimement liée à la biodiversité microbiotique. Destruction à l'origine d'un grand nombre de pathologies modernes. Aussi bien sur le plan physique que psychique. La boucle est bouclée.
"L'agriculture scientifique ne rend pas davantage que l'agriculture naturelle, et ne produit pas à un coût inférieur, ni n'engendre de profits supérieurs aux siens, par unité de surface ou par arbre. Elle n'est pas économiquement avantageuse ; autrement dit, elle ne produit pas davantage de denrées de meilleure qualité, avec moins de travail et à un coup inférieur. Non, elle est plutôt appropriée à une utilisation habile du temps et de l'espace pour créer du profit. (..) Mais, je le répète, envisagée en un sens plus large qui transcende le temps et l'espace, l'agriculture scientifique n'est pas plus économique ni productive que l'agriculture naturelle. Cette supériorité est quelque chose de fragile, d'éphémère, qui s'effondre bientôt lorsque changent l'époque et les circonstances." — Masanobu Fukuoka
La « révolution verte » a promis l’abondance, elle a surtout fabriqué une économie de dépendance. Comme le résumait Fukuoka, l’« agriculture scientifique » n’est pas intrinsèquement plus productive ni plus économique que l’agriculture naturelle ; sa supériorité apparente tient à une mise en scène du temps et de l’espace pour créer du profit, et « s’effondre » dès que changent l’époque et les conditions. Autrement dit, l’illusion de rendement naît de l’externalisation des coûts (sols épuisés, eau surexploitée, biodiversité détruite, énergie fossile engloutie) et de la socialisation des pertes (subventions publiques, endettement paysan, précarité).
"Environ 70% des revenus des agriculteurs sont constitués par des aides nationales et européennes ; la moitié d'entre eux ont un revenu négatif, avant impôt et subvention, cette proportion s'élevant à 80% chez les éleveurs ; et même après subvention, 14% ne dégagent aucun revenu ! Ce tableau stupéfiant, c'est celui d'un système qui ne fonctionne pas du tout, qui — sans même parler des dégâts écologiques, de rendements énergétiques négatifs ou de perte de qualité nutritive — ne remplit aucun de ses objectifs initiaux : rémunérer correctement les agriculteurs, pour qu'ils fournissent une alimentation abondante et satisfaisante à la portée de tous. Pour être plus précis, il y a bien abondance, mais abondance de produits mauvais pour la santé et de précarité économique." — L'Atelier Paysan, Reprendre la terre aux machines — manifeste pour une autonomie paysanne et alimentaire
Le diagnostic de L’Atelier Paysan en donne la radiographie sociale : un secteur maintenu à flot par des aides massives, où une part considérable des exploitations ne dégage aucun revenu réel, tandis que l’« abondance » qui en résulte se traduit trop souvent par des aliments pauvres en qualité et par des rendements énergétiques négatifs quand on compte l’ensemble des intrants (machines, engrais, pesticides, irrigation, logistique). La « révolution verte » prolonge ainsi le module céréalier en régime industriel : monocultures standardisées, propriété intellectuelle sur les semences, verrouillage technique et financier qui capture le paysan dans une chaîne d’approvisionnement et de dettes. À l’échelle symbolique, elle inverse la sagesse du grain : au lieu d’une cyclicité régénératrice, elle impose le flux linéaire extraction-production-déchet. D’où l’impératif, non de “revenir en arrière”, mais de sortir de cette dépendance : redonner la priorité aux sols vivants, aux semences paysannes, aux systèmes sobres en énergie et en capitaux, et à une économie qui rémunère d’abord le travail respectueux du vivant dans toutes les dimensions.
La dialectique : comment la révélation peut détruire le monstre
Le point de cette lecture conjointe est de voir que la source de la servitude peut receler l’antidote de la liberté. Concrètement, l’« émancipation » passe par deux décryptages.
D’abord, la prise de conscience politique. Les analyses de Scott et de Scheidler nous enseignent que l’État et la « méga-machine » sont des constructions humaines récentes dont l’objectif premier est de se perpétuer dans le temps en pompant l’énergie vitale d’une nature — humain y compris — mécanisée et exploitée dans cet objectif précis : l’auto-préservation. Comme l’explique Scheidler, ces systèmes oppressifs reposent sur des choix et des mécanismes particuliers – le triptyque guerre‑métal‑argent, l’exploitation des ressources – et non sur un destin inévitable. Comprendre cette genèse historique, c’est démythifier le pouvoir : l’État n’est ni naturel ni immortel. Cet état de fait légitime le droit de résister, de défier le prince, et même de fuir le système (ce que Scott appelle « exit » ). Autrement dit, la simple lecture scottienne est déjà une “révélation moderne” qui ouvre la voie à la contestation ou au retrait volontaire hors de l’emprise étatique tandis que Scheidler expose les 4 « fléaux » enchassés dans l’appareil étatique que constituent :
1. La tyrannie de la violence physique / du pouvoir coercitif — l’usage de la force, de la guerre et de l’armée comme mécanique de domination.
2. La tyrannie économique / du pouvoir socio-économique — l’enrôlement par l’économie (dette, salariat, appropriation), qui organise la soumission par les flux de richesse.
3. La tyrannie idéologique / du pouvoir du récit — les discours, les croyances, la légitimation du système, le « monde-idée » qui justifie et masque la domination.
4. La tyrannie de la pensée linéaire / du paradigme mécaniste — l’idée que le monde fonctionne selon des relations strictement causales, prévisibles, mathématiques, ce qui écrase la complexité, l’imprévisible, l’organique.
Deuxièmement, la réappropriation de la « vision originelle » de l’agriculture rappelée par Eliade comme boussole philosophique. Il ne s’agit pas de retourner aveuglément à l’agriculture ancienne, mais de réintégrer ses leçons à travers des pratiques agro-écologique dont il existe tant de variantes en terme d’approche : l’agriculture naturelle telle que pratiquée par Masanobu Fukuoka à partir des années 1970, la permaculture élaborée à la même période par le biologiste australien Bill Mollison et son élève David Holmgren ou d'autres méthodes agroécologiques qui partagent l'objectif de créer des systèmes agricoles durables et résilients en harmonie avec la nature. Ces différentes écoles reposent sur une vision du monde qui remettent profondément en question certaines dimensions fondamentales de la civilisation moderne matérialiste que dont Reclus exprima la signature de façon poétique.
"La nature reste belle quand l'agriculteur intelligent cesse d'élever et de forcer comme au hasard les plantes les plus diverses sur un sol dont il ne connait pas les propriétés, quand il comprend surtout que la terre ne doit pas être violentée, et qu'il la consulte d'abord, en interroge les gouts et les préférences, avant de lui confier ses cultures." — Élisée Reclus, La terre, tome 2 (1869)
Cette vision du monde met à mal du temps linéaire, le 4ème fléau de Scheidler, celui-là même qui rythme le mythe d’un progrès technique et quantitatif continu et infini. Le bain culturel de la civilisation moderne impose à chacun dès le plus jeune âge l’idée d’un progrès infini, linéaire, continu et accumulatif qui se traduit par toujours plus de croissance technologique et d’urbanisation. Tendances entraînant mécaniquement à une techno-structure de nature totalitaire, forme ultime de la « méga-machine », où les humains sont parqués dans des « smart cities » hyperconnectées et gouvernées par IA. De façon alternative, le modèle cyclique agricole promeut le repos (jachère), les phases successives de croissance et de décroissanc. Il enseigne la reliance (relation + sens), la résilience ainsi que la modération et la tempérance : pour subsister durablement, il faut observer des périodes de régénération et respect les cycles long de nature géobiochimique (cycle de l'eau, le cycle du carbone, le cycle de l'azote, le cycle de l'hydrogène, le cycle de l'oxygène, le cycle du phosphore,…). La reconnaissance et le respect de ces cycles conduisant au final à une agriculture bien plus efficiente que les pratiques agro-industrielles modernes contre-productives sous perfusion des subventions publiques.
Cette vision holistique du monde intègre la hiérarchie en l’englobant dans l’interdépendance universelle du tout et de ses parties. Plutôt que la structure de dominance hiérarchique pyramidale (souverain > élite > armée > paysans), la leçon agricole est celle d’un réseau organique au sein duquel s’établit une certaine hiérarchie de fonctions décentralisées. L’homme découvre qu’il fait partie d’un grand cycle où les plantes, les animaux et les humains dépendent les uns des autres et ou chaque partie contient pour ainsi dire le tout. Ce regard rejoint l’écologie : on refuse de se croire les maîtres absolus, « sommet de la pyramide évolutive », au profit d’une vision où chacun apporte à tous (comme les générations se succèdent dans la vie d’un champ). Ainsi la logique hiérarchique pyramidale en arborescence s’articule avec la logique réticulaire rhizomatique à même de rendre compte d’une structure évoluant en permanence, dans toutes les directions horizontales, et dénuée de niveaux. Une logique rhizomatique (Deleuze) qui trouve naturellement son extension dans le tissage symbiotique en un réseaux complexes de deux règnes du vivant enchevêtrés à travers le processus de mycorhisation intégrant le mycélium et les racines de la plante en une unité plurielle.
Cette vision se retrouve déjà chez des précurseurs comme Reclus qui dans L'homme et la nature publié en 1864 établissait ce constant :
« ... la terre est le corps de l’humanité, et l’homme, à son tour, est l’âme de la terre.
À mesure que les peuples se sont développés en intelligence et en liberté, ils ont appris à réagir sur cette nature extérieure dont ils subissaient passivement l’influence ; devenus, par la force de l’association, de véritables agents géologiques, ils ont transformé de diverses manières la surface des continents, changé l’économie des eaux courantes, modifié les climats eux-mêmes. Parmi les œuvres que des animaux d’un ordre inférieur ont accomplies sur la terre, les îlots des madrépores et des coraux peuvent, il est vrai, se comparer aux travaux de l’homme par leur étendue ; mais ces constructions gigantesques n’ajoutent pas un trait nouveau à la physionomie générale du globe et se poursuivent d’une manière uniforme, fatale pour ainsi dire, comme si elles étaient produites par les forces inconscientes de la nature.
L’action de l’homme donne au contraire la plus grande diversité d’aspect à la surface terrestre. D’un côté elle détruit, de l’autre elle améliore ; suivant l’état social et les progrès de chaque peuple, elle contribue tantôt à dégrader la nature, tantôt à l’embellir.
Campé comme un voyageur de passage, le barbare pille la terre ; il l’exploite avec violence sans lui rendre en culture et en soins intelligents les richesses qu’il lui ravit ; il finit même par dévaster la contrée qui lui sert de demeure et par la rendre inhabitable.
L’homme vraiment civilisé, comprenant que son intérêt propre se confond avec l’intérêt de tous et celui de la nature elle-même, agit tout autrement. Il répare les dégâts commis par ses prédécesseurs, aide la terre au lieu de s’acharner brutalement contre elle, travaille à l’embellissement aussi bien qu’à l’amélioration de son domaine. Non-seulement il sait, en qualité d’agriculteur et d’industriel, utiliser de plus en plus les produits et les forces du globe ; il apprend aussi, comme artiste, à donner aux paysages qui l’entourent plus de charme, de grâce ou de majesté.
Devenu « la conscience de la terre, » l’homme digne de sa mission assume par cela même une part de responsabilité dans l’harmonie et la beauté de la nature environnante. »
Du fait de cette optique, Reclus, plus qu'aucun autre anarchiste classique, en vient à insister fortement sur l'organisation micro-sociale émulant par biomimétisme le fonctionnement des différentes dimensions du vivant visible et invisible où s’entrelacent les logiques pyramidale, rhizomatique et mycorhizienne désormais réconciliées. Ainsi qu'il l'écrit à sa sœur Louise dès 1895: « Fondons en nous-mêmes et autour de nous de petites républiques. Graduellement ces groupes isolés se rapprocheront comme des cristaux épars et formeront la grande République ». Plus tard, en 1895, il développe son analyse de la nature de ces « républiques » : l'anarchiste conscient, dit-il, « doit travailler à se dégager personnellement de toutes les idées préconçues ou imposées, et grouper peu à peu autour de soi des amis vivant et agissant de la même façon. C'est de proche en proche, par petites sociétés aimantes et intelligentes, que se constituera la grande société fraternelle. »
On trouve dans cette idée de petites républiques de la vie quotidienne l'essence de ce qui deviendra plus largement connu dans la théorie et la pratique libertaires comme le « groupe affinitaire ». Le nombres croissant d’initiatives actuellement en place et émergent plus ou moins chaotiquement comme autant d’attracteurs étranges sont là pour en témoigner : nous assistons à la naissance d’un réseau d’îlots de résilience reliés par un destin commun. Dieu sait ce que le sort que l’avenir leur réserve.
Enfin, cette vision du monde redonne sa place au féminin et au sens du sacré immanent que le processus d'ouranisation du culte chthonien de Dionysos éclipsa le temps d’une relativement brève parenthèse historiques de quelques milliers d’années à peine. En digne représentant de l’ordre solaire apollinien, l’État et sa religion d’État monopolisent souvent le sacré version « top-down » (roi-dieu-soeil, pharaon lumière du monde manifestation du dieu solaire, idéologie nationale inspirée par les idéaux des Lumières, etc.). Le retour éliadien consiste à retrouver la manifestation du divin dans le concret immanent – dans la nature qui nous entoure, la croissance du blé, la beauté du monde vivant et des communautés locales souveraines, et non plus uniquement dans l’abstrait transcendant accaparé par les élites lettrées des centres urbains dominateurs. Ce n’est plus l’argent ou la machine qui détient le monopole du « sacré », mais la vie elle-même qui retrouve son degré originel de sacralité et dans laquelle les pratiques humaines sont invités à s’insérer. Des femmes comme Joanna Macy ou Vandana Shiva nous partage leur vision d’une spiritualité éco-féministe qui renoue avec la logique animique de l’immanence sans sacrifier pour autant la dimension transcendante de la spiritualité.
Les effondrements civilisationnels démontrent historiquement que l’émancipation est possible. La collapsologie le confirme : les vieilles civilisations agraires se sont effondrées à plusieurs reprises, ouvrant des temps de décentralisation. Scheidler explique que le système mondial (la « méga-machine », expression reprise à L.Mumford désignant non un appareil technique mais une organisation sociale qui semble fonctionner comme une machine) nourrit aujourd’hui ses propres contradictions (crise écologique, épuisement des ressources, inégalités écrasantes) . Les phases d’effondrement des mondes en transition constituent le terreau des formes de sociabilité plus locales, plus solidaires. Ainsi la fin d’une civilisation oppressive peut inaugurer un renouveau spirituel où un nombre croissant de communautés liées par un destin commun se réancrent dans les rythmes naturels, marquant l’opportunité d’une véritable régénération en chaîne d’un tissu socio-économique intégré à son milieu environnemental. A l’image d’un grain qui, dans sa mort, porte beaucoup de fruits, ces initiatives ensemencent un continent invisible qui porte en son sein la suite du monde.
Aujourd’hui, la « fin de la méga-machine » annoncée par Scheidler est peut-être la plus grande chance d’émancipation jamais offerte à l’humanité. L’essentiel est de porter la double révélation politique et cosmologique simultanément :
D’une part la révélation politique (Scott/Scheidler) : réaliser que le système-monde technocratique et oligarchique n’est pas le destin inévitable de l’humanité. Son histoire a eu un début et nécessairement une fin. Cette prise de conscience libère l’esprit de sa soumission et légitime toutes formes de résistance ou d’alternatives hors de ses circuits, qu’il s’agisse de communautés autonomes (campagnes résilientes, coopératives locales, Zomia d’aujourd’hui à l’image du zapatisme, etc.) ou de luttes démocratiques visant à enrailler les mécanismes de la méga-machine.
D’autre part, la révélation cosmologique (Eliade/Amzallagh) : se reconnecter aux « enseignements de Mère Nature ». Face à la domination extractiviste de la méga-machine, il s’agit de restaurer une vision cyclique et holistique du monde. Concrètement, cela signifie par exemple développer l’agroécologie (permaculture, semences paysannes), renforcer les circuits alimentaires courts (chaque repas devient alors un rituel re-sacralisé), et célébrer la nature et la vie (avec des fêtes agricoles, des cultes de la terre, etc.) plutôt que de laisser le monde tourner autour de l’argent et de la croissance. C’est prendre au sérieux la mort et la régénération : accepter les phases de décroissance et de dépérissement comme naturelles. Laissez les morts enterrer les morts. Le « secret du changement » n'est plus alors de combattre les anciennes réalités à l’agonie, mais d’en construire de nouvelles qui rendent l'ancien obsolète.
Conclusion
Le même geste – planter une graine – a produit deux mondes. D’un côté il a permis l’extraction et l’accumulation, la sédentarisation forcée et l’émergence des États tout-puissants. De l’autre, il a révélé à l’homme les lois sacrées du cycle, la fertilité de la terre et la promesse de renaissance. L’émancipation contemporaine consiste à réaffirmer cette deuxième leçon : non en rejetant l’agriculture qui nourrit, mais en retrouvant sa sagesse profonde avant qu’elle ne soit détournée par l’appareil étatique. En réhabilitant l’unité du vivant et sa cyclicité, nous nous donnons une arme conceptuelle pour briser le “monstre froid” du pouvoir centralisé. La fin possible de la méga-machine moderne apparait comme le moment décisif d’accepter la métamorphose en court : laisser le vieux monde périr et nourrir ce qui est en train de naître à nouveau après une brève parenthèse historique à l’échelle du temps cyclique. Alors seulement pourrons-nous retrouver la vraie liberté enfouie dans la première leçon de l’agriculture apprise par l’humanité en culotte courte élevée à l’école du vivant.
"Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé, et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire : Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ? Il leur répondit : C'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent : Veux-tu que nous allions l'arracher ? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et, à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs : Arrachez d'abord l'ivraie, et liez-la en gerbes pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier." – Mt 13:24-30


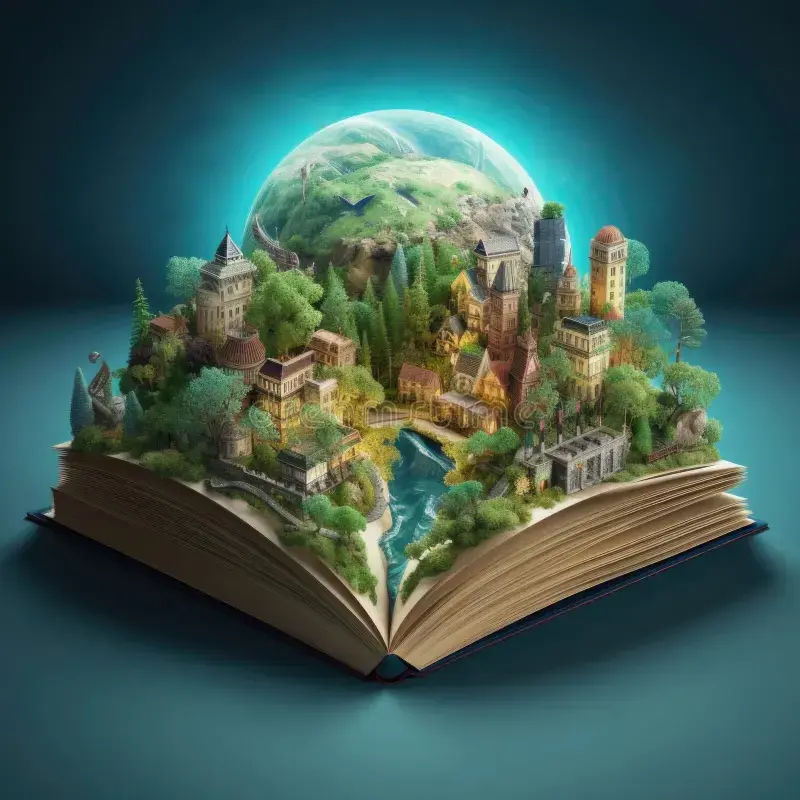
Commentaires